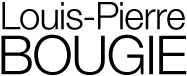Georges Leroux, Le Devoir, Livres
Publié le 15 octobre 2005
La disparition de Michel Van Schendel nous ramène à son oeuvre, elle nous dit la nécessité d’une autre lecture, ajustée sur l’horizon d’une voix qui se tait et continue néanmoins de réclamer. Ces temps derniers, le poète nous avait beaucoup donné, il avait multiplié les écrits, et sans que son écriture dont le timbre unique demeure toujours présent se disperse, elle s’était disséminée dans un nouvel espace. Je voudrais pour saluer sa mémoire tenter de dire cet espace où il nous appelle depuis ses derniers poèmes.
Son oeuvre déjà dense s’est ramifiée dans plusieurs directions nouvelles. Disséminée, ramifiée, on le notera à l’occasion d’un recueil qui invite à entrer au jardin, cette oeuvre n’a pourtant jamais quitté son terrain profondément politique, domaine où règne le conflit, où rien ne semble jamais vouloir s’apaiser. Je rappelle pour mémoire l’ouverture de son grand récit autobiographique, rédigé sur le mode d’une narration qui emprunte de multiples détours pour parler d’une vie vécue dans la poésie, mais aussi dans la revendication de justice. Engagements, luttes, combats, il y en eut beaucoup. De manière véhémente, porteuse souvent d’une colère bruyante, cette exigence imprégnait autant le poème que l’action. Dans un jeu d’allers-retours incessants, un zigzag entre le présent et le passé, entre l’enfance et le temps de la maturité, ce récit est d’abord un itinéraire qui entend rejouer, ensemble, le politique et le poétique. Un temps éventuel (L’Hexagone, 2002), c’est le titre de ce parcours fait de rigueur et de solidarité, qui nous raconte comment cet intellectuel et ce militant politique a construit ici une action qui est aussi une oeuvre de poète. Renonçant à nous guider, le poète abandonne la trajectoire toute faite et fait le voeu de ne pas nous perdre. N’est-ce pas le sens de cette communauté de l’éventuel? Tout peut arriver, la charpente peut céder, l’amour peut naître. Pour saluer Michel Van Schendel, ce récit ouvre tous les chemins.
Il nous était à peine offert que trois recueils venaient presque fuser en même temps: Choses nues, passage (L’Hexagone, 2004), L’Îil allumé. Contes de la colère triste (VLB éditeur, 2004) et Poèmes de flèche et de plume (Trait d’union, 2004). Poèmes purifiés par l’épreuve, denses, concentrés, de la plus haute exigence. Comme si cela n’était pas encore assez – et la mesure ne semblait jamais devoir être pleine, puisqu’il avait encore sur l’établi plusieurs livres -, le poète avait préparé avec Louis-Pierre Bougie un livre d’artiste, Le Jardinier (La Griffe d’acier, 2005), qui annonçait le dernier recueil publié: Mille pas dans un jardin font aussi le tour du monde (L’Hexagone, 2005).
C’est ce recueil qui définit le mieux l’espace où le poète nous convie. Plaçant nos vies au coeur de ce jardin, le poète jardinier ouvre ce nouvel espace de poésie qui est aussi une aire de pensée. La rumeur du monde, son tourment, y parvient-elle? Le tableau de Louis Pierre Bougie qui accompagne ce livre annonce tout, on y voit tourbillonner dans un vent qui les engage dans une rotation quasi céleste ces objets du monde et, comme en transparence, le poète attentif et presque effacé, allant son chemin dans l’épaisseur d’un univers rassemblé et turbulent. On y voit aussi notre image emportée dans un linceul noué. Le poète qui affronte cette turbulence pressent-il qu’il a atteint un nouveau seuil? Quand il en lut des extraits deVant ses lecteurs réunis à la librairie Gallimard le 15 septembre dernier, alors que ses forces déjà l’abandonnaient – et en particulier le dernier poème placé sous le signe de l’infini, Laisse-le -, chacun entendit un message de paix, un abandon, et reconnut un adieu. La révolte n’avait pas cédé, mais un répit avait pris forme.
Ces nouveaux poèmes sont présentés comme des poèmes du divers, cette diversité est celle du monde dans sa différence. Je lis l’ouverture, où il est question de reconnaître le monde, de le porter. Cette ouverture, je voudrais y insister, est à la fois une consigne de lecture, car elle exhorte en vue d’un propos d’unité et d’amour, mais aussi un aveu de détresse deVant toutes les fêlures et toutes les cassures par où cette diversité devient la blessure du monde, la violence, l’injustice. Casser, cassures, casses et cases, tout ce qui chute et se brise, tout ce qui se sépare et se plie pour se rompre, ce fracas est très sonore dans la suite de ces poèmes du divers, mais aussi tout ce qui dans le langage se rassemble et parvient par son nom à une existence apaisée, à une forme de consentement. Comme Héraclite, si je peux nommer ce qui se donne ici à penser sous la figure de la réconciliation impossible de l’un et du multiple, de l’arc et de la lyre, Michel Van Schendel est demeuré jusqu’au bout dialectique. M’en voudra-t-on de ce vieux mot, demeuré rivé au langage de l’utopie communiste, de l’atopie philosophique? Il ne le faudrait pas. Le poète écrit: «L’unité fomente l’opposé.» Tout se tient et s’expose dans cet acte, ce geste, ce propos: fomenter, c’est-à-dire de promouvoir en l’élaborant la diversité du monde, qui est toujours à la fois la richesse de l’altérité, de la différence, et l’abîme de la haine et de la violence. Conspirer en vue de la diversité. Encore Héraclite, tout est polemos. Le jardin lui-même est une lutte, un espace qui hésite entre l’abandon et la culture. Mais le divers recherche aussi son unité.
Thème oriental hérité du néoplatonisme arabe, le jardin nous fait remonter au mythe d’Adonis, à ces parfums secrets, à ces murets, à ces enclos où l’âme est invitée à découvrir tous les gestes de l’hospitalité et de la reconnaissance, et surtout à considérer les limites. Le monde peut y être parcouru dans son entièreté, il y est surtout reconstruit par les mains de ceux qui en travaillent la forme et qui font chaque fois le voeu de vaincre sa précarité et son désordre. Parlons un peu de cette fenêtre pour l’entendement, parlons du poète jardinier: que veut dire en effet faire le tour de son jardin comme on ferait le tour du monde? que veut dire même faire le tour? L’expression évoque une valeur de connaissance, une sorte d’intensité saturée, qui arrive à son terme: faire le tour, c’est toujours déjà avoir fait le tour, c’est connaître, c’est disposer sans dominer, c’est pour chaque être donc donner le nom que le premier jardin lui a permis de recevoir, thème adamique s’il en est, mais aussi kabbale poétique de tous ceux pour qui le jardin accueillit le premier poète au paradis.
Testament poétique
Ce recueil ultime forme le testament poétique de Michel Van Schendel, il nous invite à pénétrer dans cet enclos du monde pour aller à la rencontre des noms et des silences, des fatigues et des érosions du langage autant que de ses fugaces éclosions. Le don du poète est disposé comme le geste mille fois répété de parcourir pour faire, même si chacun sait que le tour est infini, inachevé et inachevable. Mille pas ne sont toujours qu’un pas, unique et sombre alors que «le buis de vie dure / […] / tient parole». On ne peut qu’accueillir encore l’imagerie végétale, ramifiée, disséminée de ces strophes de terre et d’air: ces «grumeaux d’arbre», ce «chêne des pauvres gens» où on entend la compassion du poète pour tous les démunis, les violentés, les opprimés. Cela, tous les jardiniers l’ont compris, eux qui refont chaque jour le monde en faisant leur jardin contre la violence du temps.
Les éléments, le monde, l’être, les êtres. Ici, comme si souvent dans ses recueils précédents, Michel Van Schendel veut faire jaillir de la masse indistincte du monde tout ce qui réclame le droit d’accéder à la parole, de demander le défendu. Sur ce seuil du langage se tiennent tant de pauvreté, tant de misère qui ne sont que des manques et des échecs du langage, là même où des paroles très simples, bien dirigées, arrivent autrement à faire être et s’agissant de l’humanité, à rendre dignes. Le poète, planté au milieu des gens, imagine et entend au-delà du présent contraignant, au-delà des morsures quotidiennes, l’appel d’autres figures encore innommées dans le temps de l’expérience, il connaît leur valeur, il veut être juste et il s’efforce vers le nom juste, même quand il s’agit de nommer ce qui manque déjà ou ce qui manquera toujours, la justice et le repos. Je retiens dans toute cette oeuvre un souci unique de dignité, de fidélité à tout ce qui réclame son nom et sa place. Les exemples ne manquent pas pour illustrer cette communauté dans l’effort de penser comme effort de faire être pour rendre justice. En témoigne ce texte placé en appendice sur les têtes coupées, hommage aux victimes, aux exclus, aux abattus. C’est du même souci, de la même ténacité, du même regard sur l’existence comme tâche et travail, mais aussi comme perte et disparition, que l’ethos de la poésie construit son alliance avec la pensée.
Lisant donc ce dernier recueil, il faut arriver à nommer cette volonté poétique du juste: il ne s’agit pas seulement de précision, mais aussi de rigueur, de sobriété, et aussi d’une amitié généreuse dans sa réclamation de justice. Mais cette recherche serait de pure forme si on n’y percevait pas, immédiatement et absolument, la simplicité, la pauvreté de ce qui est là, démuni, presque abandonné à son recueil. Et qui est justement l’exigence de justice du juste. S’il fallait, au moment de saluer la disparition de Michel Van Schendel, replacer ce recueil sur l’horizon de ce temps éventuel, de ce récit d’une vie politique et poétique de part en part, je dirais qu’il accomplit cette poétique de la justice mise en chantier depuis le début.
Collaborateur du Devoir